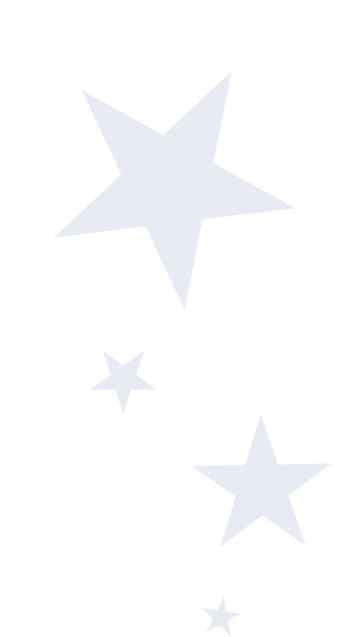Chacun sait combien la question de l’eau est cruciale à Mayotte, entre pénurie chronique, crise aiguë et assainissement encore insuffisant. Les interventions de l’Union européenne en ce domaine sont essentielles pour faire face à l’urgence et permettre de résoudre à terme les problèmes structurels de production d’eau potable et d’assainissement.
M. Ibrahim ABOUBACAR, directeur général des services des Eaux de Mayotte (LEMA), ancien député, nous fait l’honneur de répondre à nos questions.
M. le directeur, pouvez-vous résumer, pour nos lecteurs, les problématiques essentielles de la production et de l’assainissement de l’eau à Mayotte telles qu’elles se posent aujourd’hui ?
La capacité totale de production d’eau potable est de l’ordre de 43 000 m3 par jour. La demande en eau pour la consommation humaine est de l’ordre de 47 000 m3 par jour. Sachant qu’il faudrait au moins 49 000 m3 par jour de production pour stabiliser une distribution normale aux usagers : le système d’eau potable est donc en déséquilibre de – 6 000 m3 d’eau potable par jour qu’il faut rattraper par des investissements qui permettent de « franchir un palier » de plus 10 000 m3 par jour au plus vite, étant donnée la croissance démographique.
Quant au système de traitement collectif des eaux usées, il est très en retard sur l’ensemble du territoire : le nombre d’abonnés en eaux usées est le quart du nombre d’abonnés en eau potable. Dans ce domaine, tout ou presque est à faire.
Pour l’avenir, quels défis devra relever votre structure, notamment au regard des dynamiques démographiques, mais aussi sociales et économiques que connaît Mayotte et qui augmentent les besoins et les usages de l’eau ?
Le premier défi est de résorber le retard ci-dessus, compte tenu de l’accroissement des besoins qui est de l’ordre de + 4 % par an. Les investissements programmés aujourd’hui permettent de le relever à court terme, d’ici fin 2026.
Ensuite, il faudra alimenter en eau les 30 % de la population qui aujourd’hui ne sont pas raccordés au réseau : cet objectif ne peut être atteint qu’en lien avec les politiques d’aménagement, d’urbanisation et de logement du territoire, pour la maîtrise de l’occupation de l’espace. Cette action conduira à repenser l’ensemble du système de distribution de l’eau dans le territoire à moyen – long terme.
Il y a enfin à accompagner en besoins en eau potable et traitement d’eaux usées, toute l’action d’accélération des autres politiques publiques, en aménagement et en logement, qui seraient impulsées par les décideurs.
Tout cela doit être programmé, financé, engagé et suivi dans les temps : les capacités administratives et techniques de la structure doivent suivre.
Ce contexte posé, pouvez-vous nous rappeler quels projets ont d’ores et déjà bénéficié de cofinancements FEDER, dans le cadre de la programmation 2014-2020 ? Avez-vous notamment bénéficié du React EU, ce financement européen complémentaire venu abonder les enveloppes FEDER et FSE disponibles pour faire face aux conséquences de la crise du Covid-19 ?
De nombreux projets ont été cofinancés par le FEDER, je voudrais citer les plus structurants en assainissement et en eau potable. Les deux derniers projets cités ont été financés par le React EU :
- Réalisation du système d’assainissement du Centre : première tranche des réseaux de transfert ;
- Réalisation du système d’assainissement du Centre : travaux de la STEP en cours de finition ;
- Réseaux de transfert d’eaux usées dans la commune de Mamoudzou vers la STEP principale ;
- Première tranche des réseaux d’assainissement vers la future STEP de Mamoudzou Sud ;
- Première tranche des réseaux d’assainissement vers la future STEP de la Petite-Terre ;
- Interconnexion du transfert d’eau entre les deux retenues collinaires de Combani et de Dzoumogné et ouvrages liés ;
- Extension de l’usine de dessalement de Petite-Terre ;
- Renforcement du transfert d’eau potable vers le sud de l’île : Sada – Chirongui ;
- Renforcement du transfert d’eau potable du nord de l’île vers Mamoudzou.
Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées lors de cette programmation et comment LEMA s’est-elle organisée pour y faire face ?
La plus grande difficulté rencontrée dans les grands projets en général, et dans les projets d’assainissement de tous ordres, est d’ordre foncier. C’est le problème de l’acceptation des ouvrages par les élus et la population dans l’espace communal ou dans leur voisinage d’habitation. Elle perdure encore aujourd’hui. La solution c’est l’anticipation dans la programmation, le dialogue avec les élus et la négociation avec les habitants. Avec, en définitif, une volonté de mobiliser pleinement l’ensemble de l’arsenal législatif pour la maîtrise foncière dans l’intérêt général : le partenariat avec l’EPFAM ces dernières années s’avèrent constructif.
Ensuite, il y a eu des difficultés dans les capacités administratives de la structure, qui ont été surmontées, en partenariat avec l’État.
Face à la grave crise de l’eau qu’a connue Mayotte en 2023-2024, quelles solutions d’avenir sont prévues pour permettre qu’un événement de ce type ne se reproduise plus ? Comptez-vous sur les cofinancements FEDER pour les mettre en œuvre et si oui, à quelle hauteur ?
Tant que les retards évoqués plus hauts ne seront pas résorbés (donc à fin 2026), Mayotte n’est pas à l’abri de crise de l’eau du type de celle de 2023-2024 ; A date de cette interview, cette perspective n’est pas écartée pour 2024-2025.
La principale solution pour surmonter cette situation est de mener à terme le projet de construction de l’usine de dessalement de Ironi bé. Cette unité de production de 10 000 m3 par jour permettra de résorber le retard structurel accumulé.
Les opérations de réalisation de forages, soit la 6ème campagne de 10 forages en cours et la 7ème campagne de 20 forages en lancement vont apporter à cet horizon le complément nécessaire pour suivre l’accroissement démographique.
Ensuite la programmation des investissements sur la période suivante – 2028 à 2040 doit être conduite sans hésitation et sans retard, notamment la 3ème retenue collinaire de Ourovéni, et l’ensemble des ouvrages de remise à niveau du système de distribution. Il faut une volonté infaillible et un effort soutenu sur plusieurs années.
Pour cet objectif, l’ensemble de l’enveloppe envisagée dans la programmation FEDER 2022-2027 – en eau potable et en assainissement- a d’ores et déjà été fléchée sur nos principales opérations et fera l’objet de mobilisation des crédits au plus tard à la fin de l’année 2025.
Fort de votre expérience en matière de financements européens, quels conseils donneriez-vous à un gros porteur de projet d’infrastructure comme les vôtres pour gérer au mieux les subventions FEDER ?
En amont du projet, il faut avoir une vision claire des projets prioritaires sur lesquels on flèche les financements. Ils doivent porter sur les projets pour lesquels la maîtrise foncière est assurée.
En phase d’engagement du projet, il faut s’assurer du plein respect de la règlementation européenne, qui parfois contient des dispositions additionnelles à la règlementation nationale, notamment dans les marchés publics.
Enfin en amont de l’opération, il faut porter une attention particulière sur les indicateurs qui justifient les performances du projet, et être en situation de les renseigner correctement.