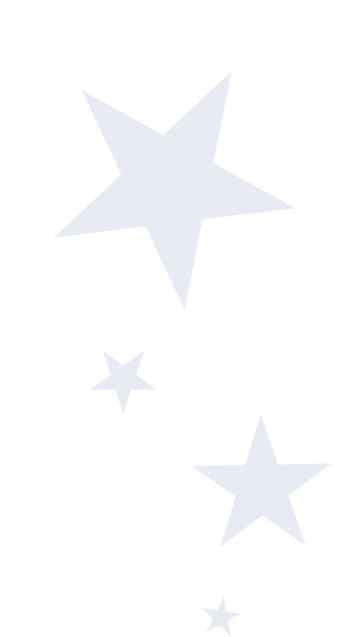L’association Apprentis d’Auteuil n’est plus à présenter à Mayotte tant ses interventions, notamment en matière d’éducation et de formation, en font un acteur essentiel du champ de l’intervention sociale. Elle porte notamment le projet M’Sayidié, cofinancé depuis 2016 par le Fonds social européen pour un montant global cumulé de près de 8M€. M. Franck SAINT-MARTIN, directeur d’Apprentis d’Auteuil, répond à nos questions.
Q – M. le Directeur, pouvez-vous, pour nos lecteurs, nous rappeler quelles sont les missions, pédagogique d’une part, éducative d’autre part, remplies par le dispositif M’Sayidié ?
M’Sayidié (« aidons-le » en shimaoré) est un centre d’accueil de jour pour les jeunes non-scolarisés de 8 à 18 ans. Notre mission est simple : accompagner ces jeunes et leur famille sur le chemin de l’école en leur proposant un accompagnement global et individuel pour les (re)mobiliser dans un projet pédagogique, éducatif et/ou socio-professionnel. Notre objectif n’est pas d’être une alternative à l’école mais bien un tremplin vers la scolarisation, en donnant ou redonnant aux jeunes et aux familles les bases et les repères pour intégrer ou réintégrer un parcours scolaire.
Q – Quels publics sont particulièrement visés, comment s’opère leur recrutement ? Combien de personnes ont bénéficié des dispositifs depuis l’origine ?
Les publics visés sont les jeunes non-scolarisés âgés de 8 à 18 ans issus des quartiers prioritaires de la ville et leurs parents.
Le recrutement s’opère de plusieurs façons :
- M’Sayidié est doté d’une équipe d’intervenants socio-éducatifs (ISE) chargée d’ « aller vers » ces publics directement dans leurs lieux de vie. Concrètement, cela signifie qu’ils maraudent dans les quartiers et qu’ils proposent différentes activités hors les murs (des jeux de société ou une activité sportive par exemple) pour repérer et aller à la rencontre des jeunes et des familles. Lorsqu’ils rencontrent des jeunes non-scolarisés, les ISE leur présentent M’Sayidié et leur proposent de venir au centre d’accueil.
- En parallèle, les jeunes et les parents peuvent aussi se présenter directement au centre d’accueil pour demander à bénéficier de l’accompagnement. Grâce au bouche-à-oreille et à la notoriété du dispositif, cette deuxième méthode de recrutement fonctionne bien aussi.
- Enfin, M’Sayidié est en lien avec de nombreux partenaires associatifs et institutionnels qui peuvent également orienter des jeunes vers le dispositif (les services de Prévention Spécialisée, le CASNAV[1]). Une liste d’attente est mise en place lorsque la capacité d’accueil de M’Sayidié est atteinte.
Depuis l’ouverture de son premier centre d’accueil de jour à Cavani en 2012, M’Sayidié s’est développé en inaugurant en 2023 une deuxième antenne à Labattoir en Petite Terre. Depuis maintenant 13 ans, ce sont plus de 3 000 jeunes et leurs parents qui ont été accompagnés par le dispositif.
Q – Comment est réalisé l’accueil des jeunes au sein de votre structure ? Comment les parents sont-ils impliqués dans cette démarche ?
Les jeunes sont accueillis sur 4 jours à la demi-journée par groupe de 12, composés en fonction de la tranche d’âge et du niveau scolaire des jeunes. Chaque semaine, ils bénéficient de 12h de cours de savoirs de base (français, mathématiques, citoyenneté) et 4h d’ateliers socio-éducatifs sur différentes thématiques comme le développement durable ou l’éducation à la santé par exemple. Chaque jeune reçoit également une collation par jour. Une à deux fois par mois, l’équipe du dispositif organise une sortie pédagogique pour faire découvrir le territoire et la culture mahoraise aux jeunes (ex : randonnée au lac Dziani, découverte de danses traditionnelles).
En parallèle de cet accompagnement collectif, chaque jeune est suivi par un travailleur social et peut solliciter un entretien individuel avec la psychologue et la référente santé du dispositif.
Les parents quant à eux, sont associés à l’accompagnement tout au long du parcours du jeune : ils sont amenés à rencontrer les intervenants socio-éducatifs dans leur quartier et sont conviés aux entretiens avec les travailleurs sociaux qui peuvent également organiser des visites à domicile pour renforcer le lien avec les familles. L’engagement des parents est essentiel pour favoriser la (re)mobilisation scolaire des jeunes. C’est pourquoi nous avons décidé en 2023 de renforcer nos actions autour de la parentalité en créant un poste de référente parentalité pour organiser des ateliers collectifs à destination des parents pour les renforcer dans leur rôle d’éducateurs.
Q – Ce dispositif a été cofinancé par le Fonds social européen. Aurait-il pu voir le jour sans cet apport financier ?
M’Sayidié n’aurait pas pu voir le jour sans le cofinancement du Fonds social européen qui représente aujourd’hui plus de 60% des ressources du dispositif. Le soutien de l’Union européenne est donc essentiel pour le maintien de nos activités.
Q – La gestion d’une subvention européenne par le porteur de projet est réputée parfois complexe, notamment parce qu’elle intervient a posteriori, donc après la certification des dépenses. Ceci suppose de disposer d’un plan de financement solide et d’une organisation administrative interne très structurée. Quel conseil donneriez-vous à un porteur de projet social pour faire face à ces enjeux importants ?
Le suivi du Fonds social européen est en effet très exigeant, et je pense qu’il est important d’être transparent sur les moyens nécessaires pour y répondre correctement. Dans notre association, nous mobilisons une équipe administrative de quatre personnes à plein temps et sur site, dédiées au suivi des dossiers des bénéficiaires et des dépenses de M’Sayidié, en lien étroit avec nos services RH et finances. Nous nous appuyons également sur un cabinet de conseil externe pour le montage de la demande FSE, le suivi opérationnel et la préparation du bilan. Par ailleurs, deux personnes sont spécifiquement en charge de la recherche de cofinancements publics et privés, car le FSE ne finance jamais l’intégralité d’un projet.
Cet investissement en ressources humaines représente naturellement un coût important qu’il faut bien anticiper. Je précise que ces postes administratifs ne peuvent pas être financés par le FSE lui-même, puisque ces personnes ne sont pas en lien direct avec les bénéficiaires finaux du projet. C’est une réalité que tout porteur de projet doit intégrer dès le départ.
L’autre enjeu majeur concerne la trésorerie. Le remboursement des dépenses se faisant a posteriori, il faut absolument pouvoir avancer les fonds. Dans notre cas, nous avons la chance de bénéficier du soutien de la Fondation Apprentis d’Auteuil qui a accepté d’avancer la trésorerie nécessaire. Sans cette capacité de préfinancement, le projet n’aurait tout simplement pas pu démarrer.
Ainsi, mon conseil principal à un porteur de projet social serait le suivant : avant de vous engager dans une demande FSE, évaluez précisément vos capacités administratives et votre solidité financière. Le FSE est une formidable opportunité, mais elle exige des moyens de gestion conséquents et une trésorerie solide ou des partenaires capables de la soutenir.
[1] Le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs.