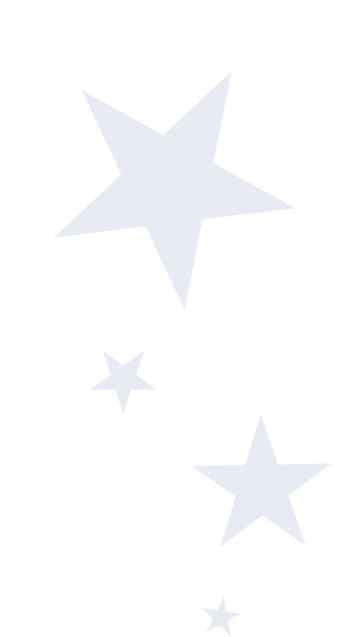L’association Mlezi Maore est un acteur majeur du champ de l’intervention sociale à Mayotte. Elle porte notamment deux projets d’insertion, l’un plus spécifiquement tourné vers la jeunesse, l’Ecole de la 2ème chance, l’autre destiné aux adultes en recherche d’insertion par l’activité économique au sein de chantiers d’insertion. Ces dispositifs sont cofinancés par le Fonds social européen. M. Hugues MAKENGO, directeur de Mlezi Maore, nous fait l’honneur de répondre à nos questions à leur sujet.
Q1- M. le Directeur, pouvez-vous, pour nos lecteurs, et pour chacun des dispositifs, nous rappeler l’origine du besoin à Mayotte et détailler leurs modalités de réalisation ?
Mayotte fait face à des défis structurels très importants : une population particulièrement jeune, des taux de chômage parmi les plus élevés de France, des niveaux de qualification faibles, un décrochage scolaire massif, et des parcours marqués par la précarité. Pour répondre à ces enjeux, Mlezi Maore a développé deux dispositifs complémentaires : l’École de la Deuxième Chance (E2C) pour les jeunes, et le Service d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) pour les adultes. Le SIAE met en œuvre des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) dans le but de promouvoir une insertion pérenne sur le marché du travail pour des personnes éloignées de l’emploi et connaissant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
L’accompagnement se structure autour de trois piliers :
- La mise au travail sur chantier, permettant de reconstruire les bases d’une posture professionnelle ;
- L’accompagnement socioprofessionnel, centré sur la levée des freins (droits, mobilité, démarches, logement, santé…) ;
- La formation, qu’elle soit technique, professionnelle, ou liée à l’acquisition de compétences transversales.
En 2024, le SIAE gérait 5 ACI dans des secteurs essentiels au territoire :
- Entretien des espaces verts,
- Agriculture,
- Mécanique automobile,
- Pépinière et agriculture durable,
- Parc Agricole de Kawéni (PAK) en partenariat avec la mairie de Mamoudzou.
Ces activités répondent à des besoins territoriaux forts tout en permettant aux personnes d’acquérir des compétences transférables vers l’emploi.
L’École de la Deuxième Chance, inaugurée en 2020, est née du constat du décrochage massif des jeunes et de l’absence de solutions adaptées pour ceux sortant du système scolaire sans qualification. L’E2C propose un parcours individualisé basé sur l’approche par compétences, comprenant :
- Des remises à niveau en français, mathématiques et numérique,
- Des immersions professionnelles,
- Un accompagnement social, citoyen et professionnel,
- Un suivi post-parcours
Q2 – Quels publics sont particulièrement visés, comment s’opère leur recrutement ? Combien de personnes ont bénéficié des dispositifs depuis l’origine ?
Les deux dispositifs s’adressent à des publics aux profils différents mais complémentaires. Pour le SIAE Le public visé est composé d’adultes majeurs en situation d’exclusion ou de forte précarité :
- Personnes sans qualification ou en situation d’illettrisme,
- Chômeurs de longue ou très longue durée,
- Bénéficiaires de minima sociaux,
- Parents isolés,
- Personnes sortant de l’aide sociale ou de structures d’hébergement,
- Personnes placées sous-main de justice,
- Personnes en situation de fragilité administrative ou résidentielle.
Le recrutement se fait via la plateforme de l’inclusion, les prescripteurs habilités (DEETS, Mission Locale, France Travail, SPIP, CHRS, E2C…), ou des candidatures spontanées analysées par les équipes. En 2024, 89 salariés en insertion ont été accompagnés, et depuis 2015, plusieurs centaines de personnes ont recruté d’un parcours au sein des ACI.
Pour l’École de la Deuxième Chance, le public ciblé est celui des jeunes de 16 à 25 ans, sans qualification professionnelle ou titulaires d’un CAP/BEP/BAC mais durablement éloignés de l’emploi. Le recrutement passe par les prescripteurs (Mission Locale, France Travail, OFII, Collectifs Jeunes…), des candidatures directes, des séances d’information et d’orientation.
En 2024, 67 jeunes ont été accompagnés en fichier actif.
Q3 – De façon plus générale, comment évaluez-vous l’impact de ces actions en matière d’insertion sociale à Mayotte ?
Pour l’E2C, les effets principaux sont la remobilisation, le développement de compétences de base, l’accès aux alternances et l’accompagnement vers l’emploi. Le dispositif redonne à des jeunes, souvent invisibles, une perspective d’avenir et un cadre structurant.
Pour les ACI, les résultats sont significatifs : 59 % de sorties dynamiques en 2024, une montée en compétences réelles via :
- les formations,
- les stages et l’alphabétisation,
- des transformations profondes dans l’accès aux droits,
- la stabilité financière,
- la confiance en soi et la capacité à se projeter,
- Un impact direct sur le développement local (agriculture durable, entretien d’espaces naturels, lutte contre l’érosion, mobilité, services de mécanique pour les acteurs sociaux…).
Ces deux dispositifs représentent aujourd’hui des leviers essentiels d’inclusion sociale et professionnelle dans un territoire confronté à de fortes vulnérabilités.
Q4 – Ces dispositifs ont été cofinancés par le Fonds social européen. Pouvez-vous nous indiquer pour quel montant total et en quelle proportion des coûts totaux de vos projets ? Comment évaluez-vous l’apport des cofinancements européens à la réussite de ces projets ?
Sur la période 2019-2022, les dispositifs cofinancés par le FSE ont été intégralement préfinancés par Mlezi Maore, conformément au cadre de gestion des fonds européens. Les dépenses réellement engagées par l’association sur ces quatre années s’élèvent à 2,36M€ . Les notifications définitives reçues à ce jour valident un financement FSE total de 1,51 M€. L’écart avec les dépenses engagées (soit environ 928 000 €) résultant des ajustements appliqués lors des contrôles de service fait ainsi que des règles d’éligibilité. Nous comprenons ces exigences, qui garantissent la bonne utilisation des fonds européens. L’apport du FSE reste fondamental : il permet de soutenir une part importante des coûts liés à l’encadrement, la formation et l’accompagnement. Toutefois, le principe de préfinancement et les délais de traitement génèrent une contrainte financière significative pour notre structure, dans un contexte où les besoins du public sont importants. Cela nous conduit à renforcer continuellement notre organisation administrative et financière.
Q5 – De nombreuses associations hésitent à solliciter des fonds européens. Quels conseils leur donneriez-vous pour se lancer ? Quelle est la condition essentielle d’après vous de la réussite d’un dossier de financement européen ?
Il est vrai que les fonds européens sont exigeants et peuvent sembler difficiles d’accès, notamment pour les structures qui débutent. Les procédures sont techniques, les justificatifs nombreux et la gestion exigent une attention constante. Pour être transparent, obtenir ces financements et les gérer nécessitent une personne réellement dédiée, ayant une bonne maîtrise administrative et une capacité d’organisation solide. Sans cette ressource, l’exercice est compliqué. Toutefois, les fonds européens ne doivent pas être vus comme un obstacle : ils deviennent accessibles dès que l’association se dote de bons outils et d’une structuration adaptée. Quelques recommandations :
- Clarifier le projet, ses objectifs et ses impacts. Le FSE finance des dispositifs structurés, alignés avec les besoins du territoire.
- Renforcer l’organisation administrative avant de déposer un dossier. Une base solide (tableaux de suivi, archivage, indicateurs) facilite beaucoup la gestion.
- S’appuyer sur l’accompagnement du GIP Europe, qui offre un soutien précieux pour le montage, la compréhension du cadre et la sécurisation du dossier.
- Intégrer la logique de qualité et d’amélioration continue. Le FSE pousse les structures à se professionnaliser, ce qui est bénéfique à long terme.
En résumé : oui, les financements européens demandent des ressources dédiées, mais ils constituent un levier essentiel pour porter des projets ambitieux et durables au service de la population.